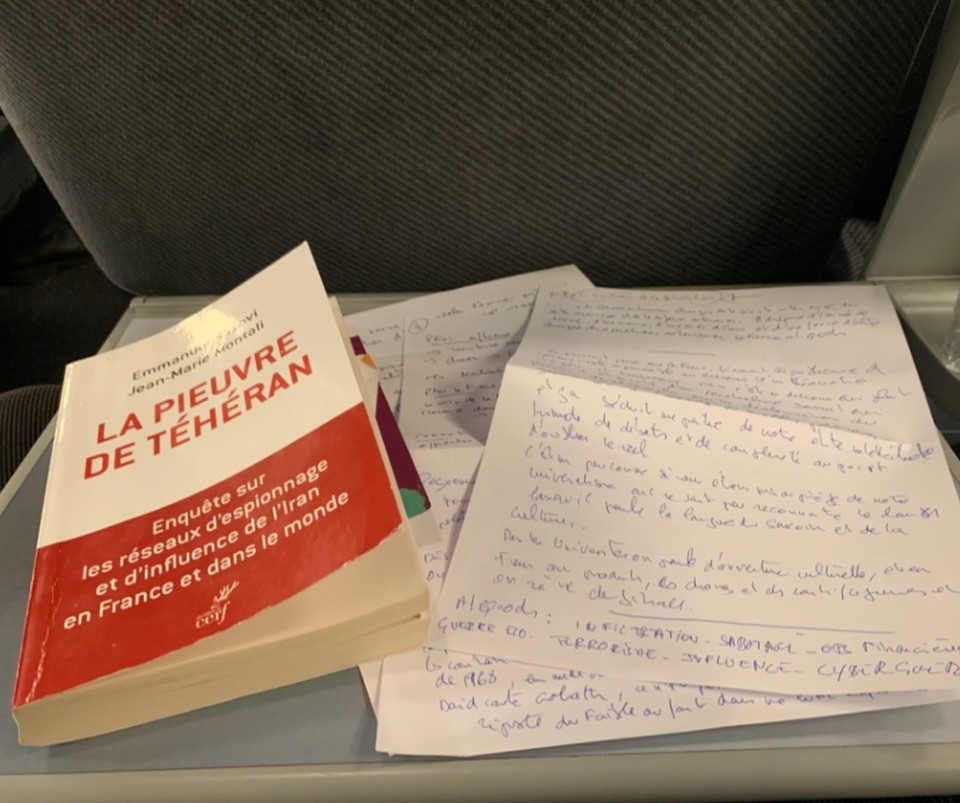L’ombre américaine plane depuis longtemps sur Caracas. Elle ne s’y projette jamais frontalement, mais elle est toujours là, diffuse, insistante, tapie derrière les crises politiques. En avril 2002, cette ombre a pris la forme d’un coup d’État éclair : Hugo Chávez, président élu, est évincé du pouvoir pendant quarante-sept heures avant de revenir, porté par la rue et une armée restée en partie loyale. Washington jurera n’avoir rien vu, rien su, rien fait. Les archives raconteront autre chose.
Ce qui se murmure aujourd’hui autour d’un Nicolás Maduro « exfiltré » et mis hors-jeu par des canaux discrets, réveille un souvenir tenace. Au Venezuela, l’histoire a la fâcheuse habitude de se répéter. Parfois en uniforme, parfois en costume-cravate, souvent avec un accent venu du Nord. Avril 2002 en reste l’illustration la plus brutale.
À l’époque, Hugo Chávez gouverne à contre-courant. Élu en 1998, il rompt avec les dogmes libéraux, reprend la main sur le pétrole, revendique une alliance stratégique avec Cuba et fait de l’« impérialisme » américain son ennemi rhétorique central. Sa popularité décline, autour de 30 %, sur fond d’accusations d’autoritarisme, de corruption et d’un conflit explosif avec PDVSA, la compagnie pétrolière nationale. En face, l’opposition se structure : patronat de Fedecámaras, centrale syndicale CTV, hiérarchie catholique, médias privés, officiers mécontents. Un front large, hétéroclite, mais uni par un objectif commun. Et attentivement observé depuis Washington.
Dès la fin de l’année 2001, les services américains suivent la situation de près. Le 6 avril 2002, un rapport interne de la CIA — Conditions Ripening for Coup Attempt — détaille avec une précision troublante ce que l’administration Bush prétendra ensuite découvrir trop tard : un coup en préparation, des militaires dissidents prêts à agir, l’instrumentalisation de manifestations pour créer le chaos, l’arrestation programmée de Chávez et de plusieurs hauts responsables. Le document circule largement. Personne n’alerte Caracas.
Dans le même temps, les futurs acteurs du putsch défilent à Washington. Pedro Carmona, qui se proclamera président par intérim, y est reçu. Otto Reich écoute, Elliott Abrams valide, John Negroponte est informé. On parle de « dialogue démocratique ». Le vocabulaire est souple, la mémoire sélective. Le National Endowment for Democracy injecte des millions de dollars dans des organisations d’opposition, officiellement pour soutenir la société civile. Officieusement, ces structures joueront un rôle central dans la déstabilisation.
Le 11 avril 2002, tout s’emballe. Une marche massive dévie vers le palais présidentiel. Des tirs éclatent au pont Llaguno. Dix-neuf morts. Le récit médiatique est prêt avant même que la fumée ne se dissipe : les chaînes privées accusent Chávez. L’armée refuse d’activer le plan de maintien de l’ordre. Dans la nuit, le président est arrêté. Dès le lendemain, à Washington, on explique qu’il a « démissionné ».
Pedro Carmona dissout l’Assemblée nationale, la Cour suprême et la Constitution d’un trait de plume. Un putsch propre, expéditif, presque administratif. Les États-Unis reconnaissent le nouveau pouvoir. Le New York Times salue un « retour à la démocratie ». Quarante-huit heures plus tard, la rue se soulève, l’armée se divise, Carmona fuit. Chávez revient. Les images font le tour du monde. Les démentis aussi.
Les enquêtes ultérieures blanchiront officiellement Washington, tout en confirmant l’essentiel : les États-Unis savaient. Beaucoup. Trop pour n’avoir rien dit. Pas assez, diront-ils, pour être coupables.
C’est cette zone grise qui resurgit aujourd’hui avec Nicolás Maduro. Les méthodes ont évolué, le lexique aussi — sanctions, pressions judiciaires, négociations secrètes, mandats internationaux — mais la logique demeure. Lorsqu’un pouvoir latino-américain échappe au contrôle, il ne tombe jamais seul. Et lorsqu’il chute, Washington assure toujours n’avoir fait que regarder.
En 2002, Chávez avait survécu à quarante-sept heures d’effacement. En 2026, Maduro affronte une séquence plus spectaculaire. Mais au Venezuela, chacun sait désormais qu’un président peut disparaître sans mourir politiquement. Et que ce genre de coups d’État finit toujours par produire le même effet : une couche supplémentaire de discrédit sur ceux qui prétendent incarner la démocratie.