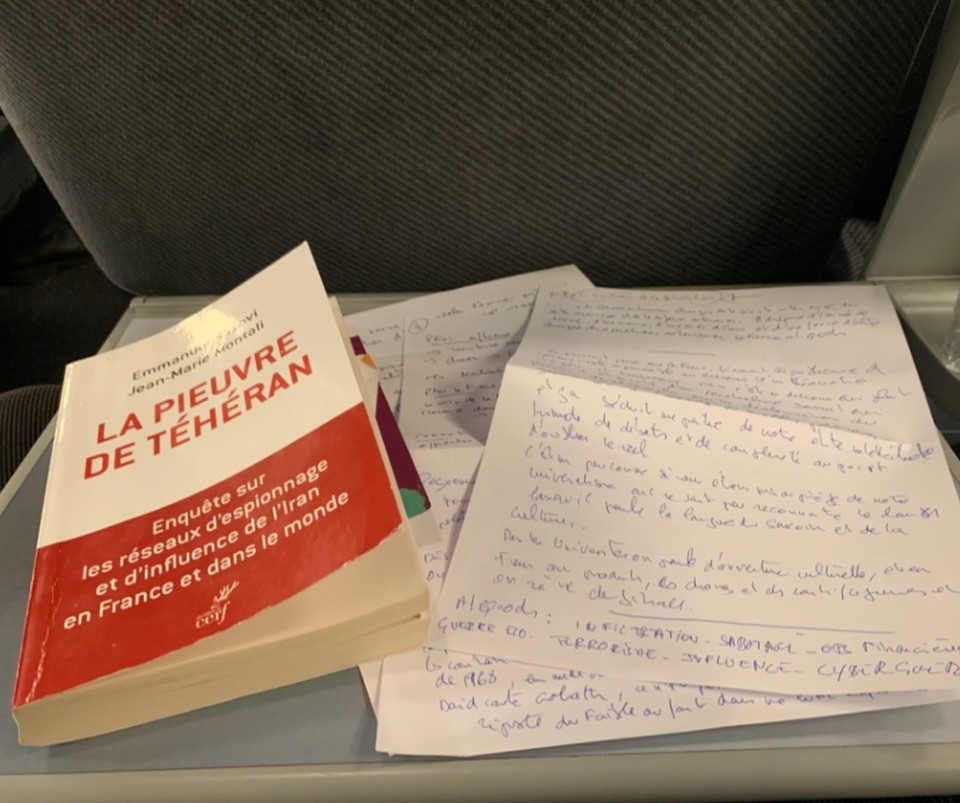Bombardements nocturnes, arrestation d’un chef d’État en exercice, exfiltration façon polar et discours martiaux recyclés. En janvier 2026, les États Unis ont décidé que le feuilleton vénézuélien devait se terminer par un coup de force. Récit d’une intervention éclair qui sent le déjà vu, le pétrole et l’impérialisme décomplexé.
Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, Trump a plongé le bec et décidé de lâcher la cavalerie au Venezuela. Frappes ciblées, hélicoptères au-dessus de la capitale, bases militaires neutralisées. Et, point d’orgue, Nicolás Maduro arrêté puis exfiltré. À Washington, on a salué une opération « brillante ». À Caracas, on a surtout vu une humiliation nationale, filmée en direct.
Maduro finit menotté
Donald Trump a revendiqué l’opération sans détour. Une frappe à grande échelle, a-t-il dit, comme on parlerait d’un coup de propre dans un quartier mal famé. Maduro, ancien chauffeur de bus devenu héritier d’un chavisme ossifié, aurait été capturé par des forces spéciales américaines, accompagné de son épouse Cilia Flores, puis embarqué vers les États Unis. Direction New York, district sud, là où les procureurs fédéraux rêvent depuis des années de l’exhiber comme le trophée ultime de la guerre contre la drogue. Le narco État, selon la terminologie américaine, venait d’être privé de son chef.
Sur le terrain, la réalité avait un goût moins cinématographique. Des explosions à La Carlota, au Cuartel de la Montaña où repose le corps sacralisé d’Hugo Chávez, des survols d’hélicoptères au-dessus de quartiers déjà exsangues, des coupures d’électricité et une population habituée aux pénuries mais pas aux bombes.
Le gouvernement vénézuélien a parlé d’agression impérialiste, formule usée jusqu’à la corde mais soudain redevenue littérale. La vice présidente, Delcy Rodríguez, a réclamé une preuve de vie de Maduro, comme si l’ancien homme fort était déjà entré dans la catégorie des disparus. Le ministre de la Défense Vladimir Padrino López a promis une résistance murale, expression grandiloquente pour un pays dont l’armée n’a jamais été aussi fracturée.
À Moscou et à Téhéran, les communiqués ont fleuri pour dénoncer une violation du droit international. À Bogotá, on a appelé à une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU, exercice diplomatique aussi rituel qu’inefficace. À Washington, on a surtout savouré. Depuis 2020, Maduro est inculpé pour trafic de drogue et corruption. En 2025, la prime pour sa capture avait été portée à cinquante millions de dollars, comme au bon vieux temps du Far West. Il ne manquait plus que l’arrestation. Elle est arrivée, emballée dans le drapeau étoilé.
La guerre annoncée depuis des mois
Cette intervention n’est pourtant pas tombée du ciel. Depuis des mois, les États Unis resserraient l’étau. Des frappes répétées contre des bateaux soupçonnés de narcotrafic dans les Caraïbes et le Pacifique oriental, officiellement au nom de la lutte antidrogue, officieusement comme un avertissement. Des dizaines de morts, des juristes parlant d’illégalité, et une première attaque sur un quai vénézuélien qui avait déjà franchi un seuil.
En parallèle, une accumulation militaire digne d’un manuel de dissuasion. Porte avion, destroyers, sous-marins, bombardiers stratégiques, drones, Marines et forces spéciales massés à quelques encablures des côtes. Le message était clair et Maduro l’avait reçu.
Le président vénézuélien avait tenté la carte de la négociation tardive. Promesses de coopération antidrogue, ouvertures pétrolières, insinuations d’un éloignement de la Russie et de la Chine, jusqu’à évoquer une démission différée dans un avenir brumeux. Tout cela a été balayé par Trump et son secrétaire d’État, Marco Rubio. Le cartel de los Soles, supposément dirigé par Maduro, avait été classé organisation terroriste étrangère. À partir de là, la logique n’était plus diplomatique mais policière, voire punitive.
À l’intérieur du pays, Maduro avait réagi comme il l’avait toujours fait, en serrant la vis. Arrestations massives après les contestations des élections de 2024, opposants qualifiés de traîtres, dissidence assimilée à une cinquième colonne au service de Washington. L’intervention américaine est venue parachever un régime déjà vidé de sa légitimité mais pas de sa capacité de nuisance.
,
Une vieille rancune, toujours la même recette
L’histoire entre Washington et Caracas est une vieille rancune. Depuis Chávez, le discours anti impérialiste servait de ciment idéologique pendant que l’économie pétrolière se désagrégeait. Les sanctions américaines ont aggravé une crise humanitaire déjà profonde. La reconnaissance de Juan Guaidó en 2019 a échoué dans le ridicule diplomatique.
Les élections de 2024, remportées par Maduro dans un climat de suspicion généralisée face à une opposition incarnée par María Corina Machado, ont achevé de convaincre Washington que la voie politique était bouchée. Restait la méthode Noriega. En 1989, les États Unis avaient envahi le Panama pour arrêter un autre chef d’État accusé de trafic de drogue. Trente six ans plus tard, l’histoire se répète, avec la même assurance et les mêmes critiques. Au Congrès, certains élus ont dénoncé une opération sans autorisation, donc illégale. Les protestations sont restées marginales.
Derrière la morale, le pétrole
Derrière le discours sécuritaire, les enjeux sont limpides. La drogue, bien sûr, éternel justificatif. Le pétrole, surtout, puisque le Venezuela possède les plus grandes réserves mondiales et qu’un changement de régime ouvrirait des perspectives très concrètes à des groupes comme Chevron. La géopolitique enfin, car affaiblir un allié de Moscou, Pékin et Téhéran en Amérique latine reste un objectif stratégique. Le risque est connu. Une flambée anti américaine dans la région, une instabilité prolongée, un pays déjà vidé par l’exode plongé dans un vide de pouvoir.
Fin de règne, début des ennuis
Nicolás Maduro, s’il est bien jugé à New York comme l’annonce Washington, deviendra le symbole d’une époque qui se termine dans les soutes d’un avion militaire. Le Venezuela entre dans une phase encore plus incertaine. La chute d’un homme ne fait pas une transition politique. Mais à Washington, on préfère parler de victoire. À Caracas, on compte les dégâts et l’on se demande, une fois de plus, combien de temps le pays servira de cham
p d’expérimentation au grand voisin.