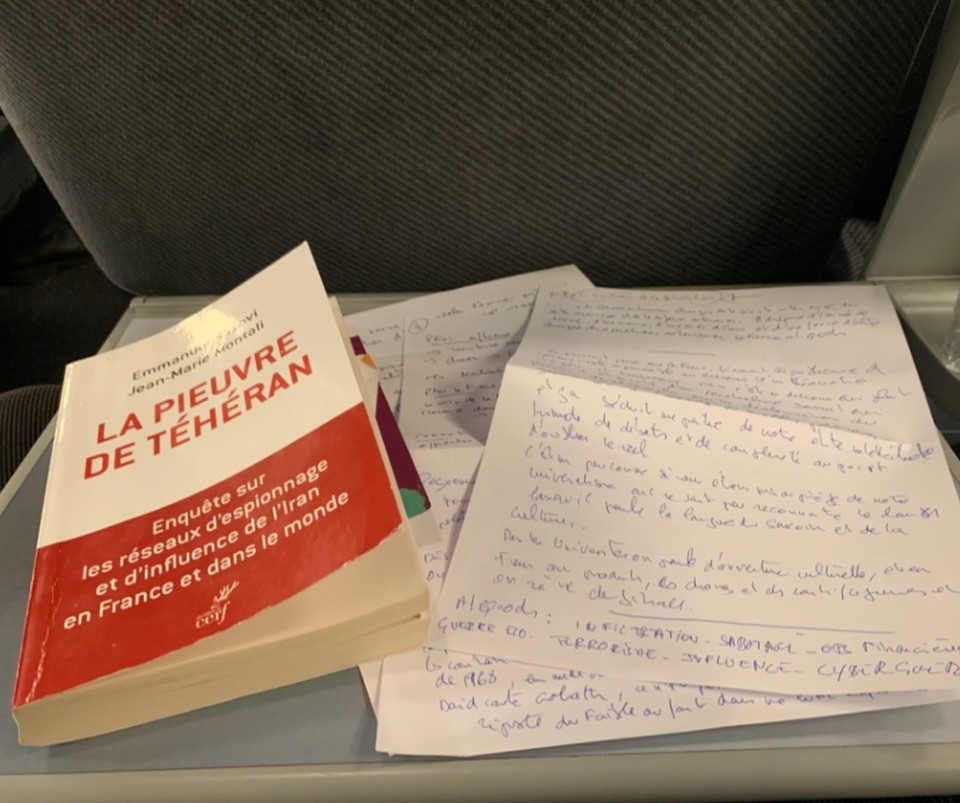Mohammed Harbi est mort le 1er janvier 2026 à 92 ans, selon une annonce de l’historien Fabrice Riceputi. Ancien cadre du FLN devenu son historien le plus critique, intellectuel marxiste et figure majeure de la mémoire de la guerre d’Algérie, il laisse une œuvre dérangeante et essentielle, consacrée à la déconstruction des mythes nationaux et à la difficile réconciliation des mémoires algérienne et française.
La nouvelle a circulé d’abord à voix basse, comme souvent quand il s’agit des grandes consciences. Mohammed Harbi est mort le 1er janvier 2026, à 92 ans, selon une annonce faite par l’historien français Fabrice Riceputi. En attendant une confirmation officielle d’Alger ou de Paris, l’essentiel est ailleurs : avec Harbi disparaît l’un des derniers témoins majeurs de la guerre d’indépendance algérienne, et surtout l’un de ses plus féroces analystes. Un homme qui avait fait de la mémoire un champ de bataille et de l’histoire une discipline indocile.
Né le 16 juin 1933 à El Harrouch, près de Skikda, dans le Nord-Constantinois, Mohammed Harbi appartient à cette génération d’Algériens que la colonisation française a formés sans jamais parvenir à les domestiquer. Issu d’une famille aisée, il suit un parcours scolaire d’excellence : El Harrouch, le collège Luciani de Skikda, puis Paris, Sainte-Barbe, le baccalauréat en poche dès 1950, avant des études d’histoire. À quinze ans à peine, il choisit son camp : en 1948, il adhère au MTLD, matrice du futur FLN. Le choix n’est pas romantique, il est politique. Et définitif.
Lorsque la guerre éclate en 1954, Harbi est déjà dans l’ombre du combat. En France, il agit dans la clandestinité, mobilise des réseaux intellectuels, participe à la structuration idéologique du FLN. Pendant la guerre, il devient un rouage central : responsable de la presse de la Fédération de France du FLN, ambassadeur en Guinée, puis secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du GPRA. Il participe aux accords d’Évian, observe les lignes de fracture, mesure déjà le prix des compromis. Proche de Krim Belkacem, conseiller d’Ahmed Ben Bella, il rêve d’une révolution socialiste authentique, d’une Algérie où le peuple serait armé politiquement autant que militairement. Une hérésie pour les futurs vainqueurs de l’intérieur.
Le coup d’État de Boumédiène en 1965 referme brutalement la parenthèse. Harbi est arrêté, emprisonné sans jugement pendant cinq ans, puis assigné à résidence. Le régime sait ce qu’il fait : Harbi n’est pas un opposant ordinaire, il est une mémoire vivante, un idéologue, un homme qui écrit. En 1973, il s’évade, faux passeport en poche, direction la Tunisie puis la France. L’exil sera long, dangereux, sous menaces constantes : services secrets algériens, islamistes, ultranationalistes français. Trois haines pour un même homme, c’est souvent le signe qu’il touche juste.
En France, Mohammed Harbi devient historien au sens plein du terme. Non pas celui qui empile les archives, mais celui qui les interroge. Il enseigne, soutient, publie. Aux origines du FLN dynamite le récit officiel. Le FLN, mirage et réalité met à nu les luttes internes, les violences fondatrices, les confiscations du pouvoir. Harbi ose écrire ce que l’Algérie officielle refuse de lire : l’indépendance n’a pas tenu toutes ses promesses, et le nationalisme, sanctifié, a souvent servi d’alibi à l’autoritarisme.
C’est aussi à Paris que se noue l’un des dialogues les plus féconds de l’historiographie contemporaine : celui entre Mohammed Harbi et Benjamin Stora. L’un, ancien acteur de la révolution devenu son critique le plus lucide. L’autre, historien français des mémoires blessées. Ensemble, ils tentent l’impossible : faire dialoguer les récits algériens et français sans les diluer. Harbi apporte l’intérieur du FLN, ses mensonges, ses tragédies. Stora y ajoute les mémoires françaises, pieds-noirs, harkis, appelés. Leur travail commun marque durablement le débat public, jusqu’au rapport Stora de 2021, où l’ombre de Harbi plane sans jamais s’imposer.
Libertaire socialiste, hostile aux dogmes comme aux mythologies, Harbi n’a jamais cessé d’intervenir dans le débat algérien. Même pendant la décennie noire, même lorsque revenir au pays signifiait risquer sa vie. Jusqu’à la fin, il parlait des prisonniers politiques, de Boumédiène, des silences de l’État, rappelant que l’oubli est toujours une politique.
Mohammed Harbi est mort, mais son œuvre demeure, dérangeante, inconfortable, indispensable. Dans un paysage mémoriel saturé de postures, il aura été une chose rare : un homme fidèle à ses contradictions, convaincu qu’aucune nation ne se construit durablement sur le mensonge. À l’heure où Paris et Alger continuent à s’enliser dans les non-dits, Harbi laisse une leçon simple et cruelle : on ne réconcilie pas les mémoires en les caressant, mais en les affrontant.